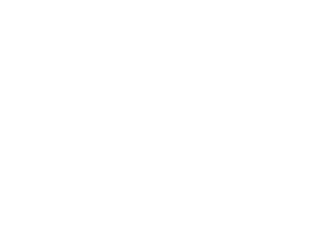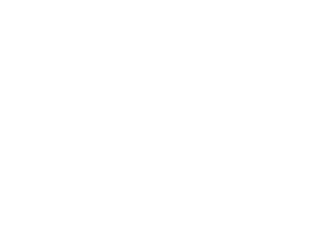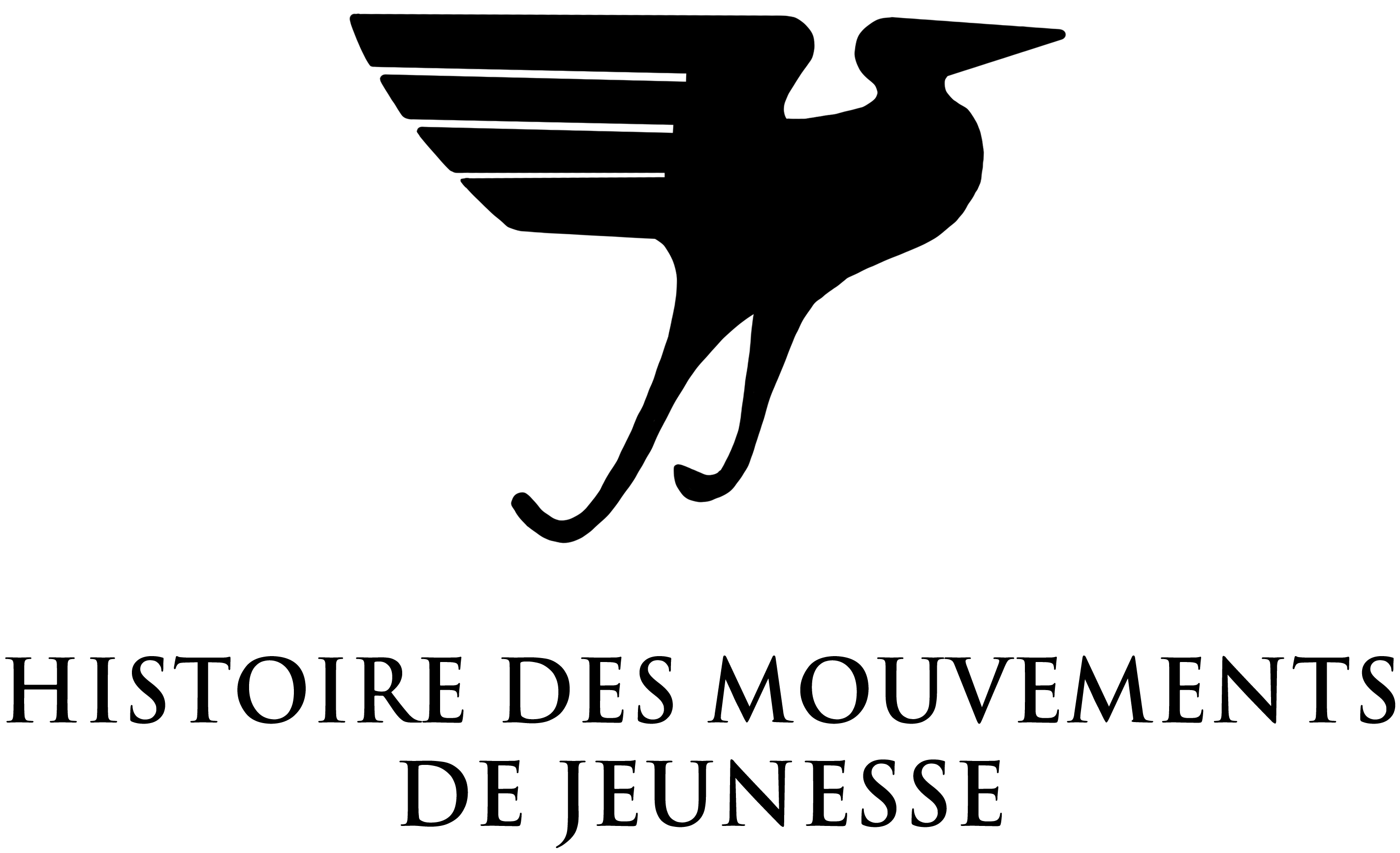Il y a peu de poètes dont les œuvres, devenues le bien commun de la nation, sont passées souvent inconsciemment, dans l’âme des êtres simples, de ces êtres qui se plaisent à en citer parfois quelques lignes ou quelques vers, et ceci, depuis leur plus tendre enfance.
L’Allemagne possède en Joseph von Eichendorff un poète « populaire », dont les vers et la prose savent nous charmer.
Mais, rien que son nom éveille des sentiments bien définis et nous conduit tout naturellement au romantisme, à la poésie, à la beauté.
Une nostalgie magique et pourtant si naturelle grandit en nous…, nostalgie du pays natal, des forêts et des plaines, des montagnes et des vallées, des sources et des fleuves, du ciel et des étoiles, du foyer et des lieux retirés et tranquilles.
Les œuvres de Eichendorff sont certainement la meilleure illustration de sa vie, car on trouve, surtout dans ses poèmes, le témoignage d’une nostalgie unique et indicible. Cependant, le jeune poète n’est pas resté à l’écart du monde, il ne s’est pas contenté d’être le rêveur perdu dans les nuages, que l’on se plaisait à voir en lui. Les chante et les sonnets ne lui suffirent pas : à côté d’une existence d’étudiant mouvementée, à Halle, Heidelberg, Berlin et Vienne, il y a celle du militant, de l’homme d’action.
Eichendorff est entré plus d’une fois en contact avec la France (alors sous le régime de Napoléon et en lutte avec la Prusse). L’orage qui devait éclater avec la Révolution française pesait déjà sur l’Europe lorsque le poète vint au monde.
Les événements qui se dessinaient à l’horizon de l’heureux Lubowitz (château de son enfance) n’étaient qu’une lumière fugitive et lointaine dans un ciel noir. Le petit Joseph couché dans l’herbe haute du parc écoute son père et son grand-père parler des événements actuels. Le messager qui doit apporter les nouvelles les plus récentes de Paris est attendu avec une impatience fiévreuse, car, même en cet isolement, à l’abri de toutes les tempêtes de l’époque, dans ce château tranquille, les coups de tonnerre assourdis de l’histoire du monde semblent éveiller un écho interrogateur. C’est là, au milieu de cette paisible idylle qu’un officier, venant de Ratibor, apportera la nouvelle de l’exécution de Louis XVI, et, sous l’impression tragique de ce message, Eichendorff, si petit qu’il fût à cette époque, jeta ses regards vers les Carpates aux reflets bleus, comme s’il pressentait que l’avenir lui serait dévoilé de là-bas. Les événements de l’époque agissaient fortement sur lui et il se sentait lié à la tragédie historique qui se déroulait en France.
Plus tard, à Heidelberg, les deux frères Eichendorff, qui furent longtemps inséparables, se mirent à l’étude du français ; le jeune Joseph se trouva donc, pour la première fois, en contact véritable avec la culture du pays voisin. Les chroniques personnelles du futur poète nous relatent les événements de l’époque napoléonienne, elles nous parlent aussi du voyage qu’il fit en cabriolet avec son frère, tout d’abord à Spire, puis en France, pour voir les soldats espagnols qui venaient d’y arriver. Les passeports délivrés au jeune baron Joseph âgé de vingt ans, par la police de Heidelberg, nous le décrivent ainsi : « taille moyenne, visage mat, nez pointu, cheveux blonds, yeux gris, et dans son compte rendu de voyage, le poète nous rapporte d’autre part, les impressions suivantes : « Dans une vallée divinement belle, dominée à l’arrière-plan par les Vosges, les troupes défilent sans cesse : on voit des officiers montant des étalons d’Andalousie, des cavaliers au visage mauresque, tout bronzés, des fantassins, tambours en tête et enfin, des conscrits du centre de la France, dressés par des officiers français. De nombreux étudiants en voiture à cheval contemplaient ce défilé. »
A Heidelberg, quelque temps après, Eichendorff eut l’occasion de voir le roi de Württemberg que Napoléon avait salué à Francfort, et, il note dans ses tablettes : « Un monstre royal, une vraie caricature, entourée d’une foule de hussards et d’estafettes. »
Le 5 avril 1818, les frères Eichendorff partirent pour Paris ; ils traversèrent Strasbourg « belle et vieille ville certes, mais, moins allemande et moins fidèle aux traditions que Nuremberg, avec sa cathédrale qui dirige toujours ses regards vers la mère-patrie et semble être la vivante incarnation d’une faute ancienne, mais pas effacée » ; ils traversèrent la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne, et arrivèrent à Paris, par le faubourg Saint-Martin, où l’on venait d’ériger le nouvel Arc-de-Triomphe. Un monde nouveau s’ouvrait aux jeunes patriotes allemands. Ils sillonnèrent les routes d’un pas léger, visitèrent les monuments et ne manquèrent pas d’admirer les trésors artistiques du Louvre. Görres (Joseph Görres) les avait chargés de consulter très attentivement la version du livre populaire des enfants d’Aymon, de déterminer la position de l’auteur, son art à traiter le sujet, sa force, de voir enfin ce que l’on pourrait tirer de son histoire et de rendre par là même un immense service à la poésie ancienne. Leur séjour dura plusieurs semaines ; des excursions aux environs de Paris vinrent compléter leurs impressions sur cet autre monde que Guillaume, frère du poète, décrit plus tard en ces lignes :
« Il y a quelque chose de merveilleux dans les campagnes françaises, quelque chose qui nous avait souvent frappés au cours de notre premier voyage : on a le sentiment, en les quittant, qu’il faut absolument y revenir, les revoir comme un être cher dont on ne peut se passer, certes, mais qui ne peut vous faire oublier la mère-patrie. » Guillaume exprime, en ces derniers mots, le mal du pays, qui forme une sorte de pont magique et romantique entre l’Allemagne et la France dans les nouvelles de Joseph.
La force de Eichendorff, précisément dans le domaine de la nouvelle, consistait à bâtir ses récits et ses plus beaux poèmes sur des impressions et des expériences d’études. Il est de toute vraisemblance qu’il a profité de son séjour à Paris pour visiter aussi Versailles, la ville des rois : son « Château Durande » en est une évocation poétique et charmante : quant aux chapitres consacrés à Paris et aux premiers éclairs de la Révolution, ils sont nés des promenades et autres excursions faites au cours du premier voyage en France.
Joseph von Eichendorff épousa sa bien-aimée Louise, le 5 avril 1815. Des ombres planent sur ce mariage et font déjà pressentir une nouvelle séparation. Napoléon s’était enfui de l’île d’Elbe et avait reconquis le peuple et l’armée, en vingt jours à peine. Le poète qui fut témoin de la défaite du grand Empereur se retrouva à Paris en juin 1815 ; il bivouaqua même en juillet sur le Pont-Neuf.
Derrière le rêveur contemplatif se cachait en lui un être avide d’agir, et ce désir donna à sa vie et à sa production poétique un caractère de belle virilité.
Ce voyage à Paris fut un événement aussi fructueux que charmant pour Joseph von Eichendorff…, un événement dont le souvenir se fixa en son âme d’écrivain militant et qui trouva son expression dans de nombreux poèmes.
par Walter-Eberhardt DOELL
(Traduit de l’allemand par Horace NOVEL) Comoedia, 25/12/1943
Scènes de la vie d’un propre à rien – Aus dem Leben eines Taugenichts – Joseph von Eichendorff