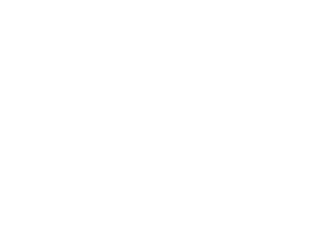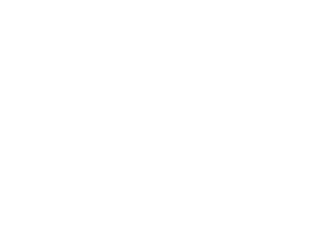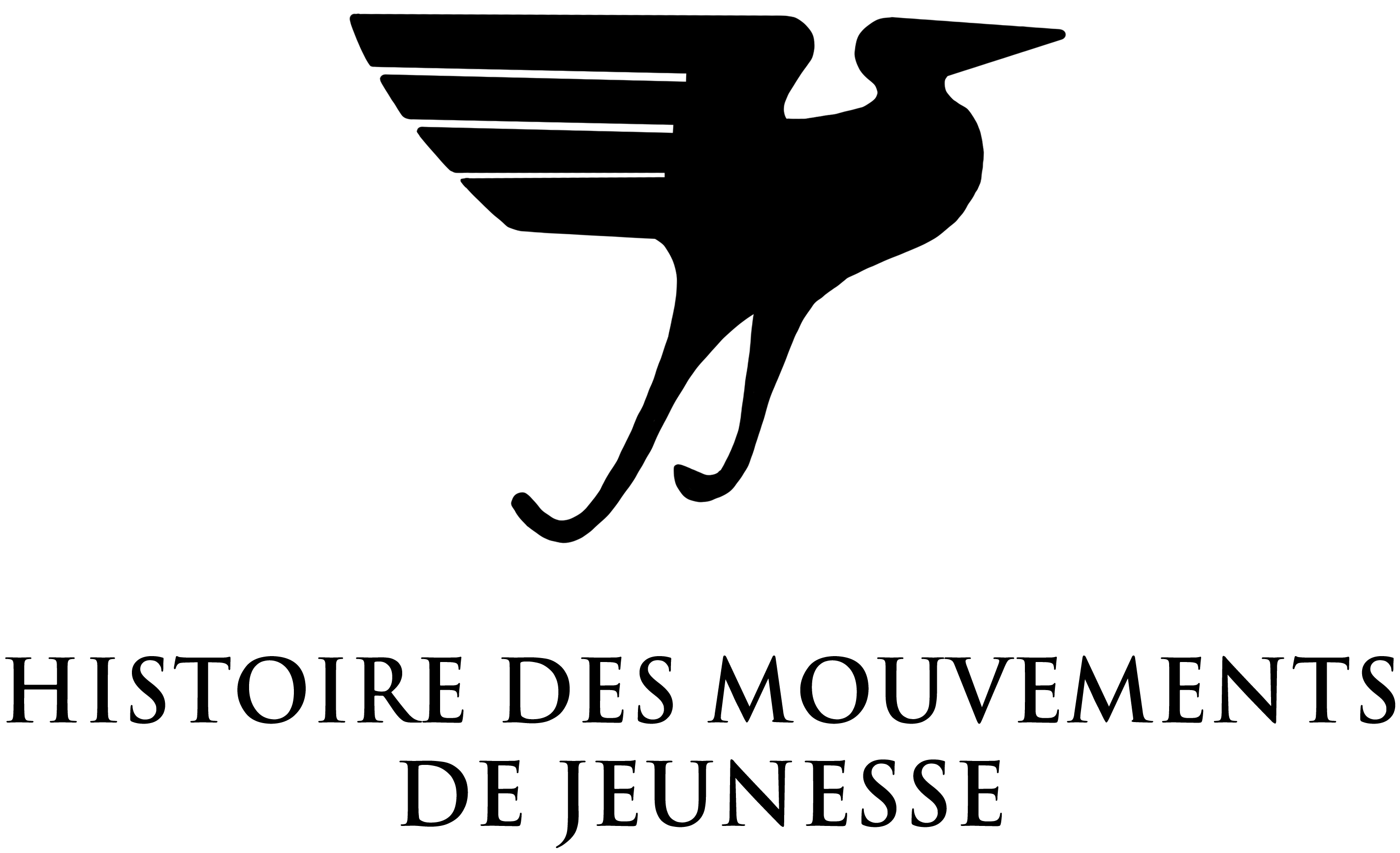Dans cet article, Thierry Maulnier montre que la jeunesse française, déjà indifférente à la culture avant la guerre, en est venue après la défaite à la rejeter ouvertement, lui reprochant son inutilité et son caractère bourgeois. Maulnier invite à ne pas condamner trop vite cette révolte : si la culture a manqué à incarner la vie et à nourrir réellement les jeunes, il faut la réconcilier avec l’élan vital et les forces neuves de la jeunesse pour qu’elle redevienne féconde.
Beaucoup d’observateurs se plaignent de la défiance ou du dédain que la jeunesse française a commencé de manifester à l’égard de la culture. Durant les années qui ont précédé la défaite, cette défiance et ce dédain n’apparaissaient encore que sous une forme passive. De très nombreux jeunes gens ne montraient qu’un zèle modéré pour les exercices où l’esprit ne recherche que son propre enrichissement, pour les activités désintéressées de la pensée, pour l’art, pour la lecture. Le niveau des études classiques s’abaissait d’année en année, les élèves de nos écoles secondaires avouaient aux examens une ignorance stupéfiante en ce qui concernait les lettres et les arts de leur pays, les événements de son histoire et les œuvres de la pensée universelle — les plus brillants d’entre eux n’avaient retenu des richesses de la culture générale que les éléments les plus formels et les plus immédiatement utilisables ; ils avaient retenu des noms et des dates, lu avec attention les textes fixés au programme, mais comme en s’acquittant de corvées ennuyeuses ou d’exercices seulement destinés à mettre en valeur les agiles dispositions de leur esprit. Nulle part, on ne sentait chez le jeune homme mis au contact des ressources de la culture la certitude de compléter l’homme en lui, le plaisir d’affiner son goût, la passion de connaître. — L’ardeur, l’attention des jeunes gens se détournaient naturellement vers la politique et les possibilités ou simulacres d’action qu’elle proposait, vers la camaraderie et l’amour, vers la vie physique et le sport, enfin vers les activités utilitaires destinées à leur permettre de réussir dans une carrière honorable et avantageuse. Il n’y avait pas pour eux dans la culture de joies incomparables, de paysages pleins de splendeurs, mais seulement des obligations d’un ordre strictement scolaire et les mornes sentiers par lesquels il fallait passer pour aboutir au succès dans des examens nécessaires.
Il y a donc longtemps déjà que la jeunesse fuit ou se détourne devant la culture. Mais le fait nouveau est que désormais elle s’attaque à la culture ouvertement, affirme qu’elle n’a plus besoin de la culture et que la culture n’a plus à attendre d’elle de respect, proclame que la primauté appartient désormais à des activités plus simples, plus saines, plus immédiatement utilitaires. Le désir, le besoin de profondes métamorphoses, nés de la défaite, paraissent avoir rejeté la culture parmi les institutions décrépites dont une vie nouvelle doit d’abord se dégager. L’intelligence a mauvaise presse : c’est elle, paraît-il, qui est la cause de tous nos malheurs ; elle est par nature impuissante, ignorante des réalités, corruptrice, elle a fait de nous un peuple d’agrégés myopes et d’esthètes décadents, et notre défaite est moins celle de diplomates maladroits, d’avions trop peu nombreux et d’une armée privée de chars que celle des hommes qui prenaient plaisir à lire un texte de Virgile, de Spinoza, ou de Valéry. La jeunesse est donc séduite par un vigoureux nationalisme, par le culte du grand air, de l’effort, du sang et des énergies instinctives, par la vie d’équipe et de camp, les travaux manuels et les chansons de marche, — par une vie où il n’y a plus de place pour Léonard de Vinci, Jean-Sébastien Bach, ou Platon, ou Racine. Chose grave, un bon nombre des chefs de la jeunesse semblent considérer avec indulgence, sinon favoriser, ces étranges excès. On peut feuilleter d’innombrables « journaux de jeunes » pour y trouver une seule page qui soit consacrée à une formation intellectuelle véritable, et un homme qui occupe un poste important dans une organisation de jeunesse a osé dire récemment que l’avantage des airs populaires et les chants de marche est qu’ils « empêchent de penser ».
Tout cela est sans doute absurde. Mais il ne l’est pas moins de s’indigner, et de crier à la barbarie, et d’adopter à l’égard d’une jeunesse qui apporte au pays le trésor inestimable d’un sang frais, de réactions vivaces et brutales et de saines violences, le comportement des vieux professeurs tentés de considérer comme un attentat direct à la Grèce d’Olympie et à la Rome des Légions la diminution du nombre de leurs élèves voûtés ou tuberculeux. Il serait meilleur de se demander si dans cette indifférence, puis dans ce ressentiment de plus en plus grand de la jeunesse à l’égard de la culture, — à l’égard de toute activité difficile et désintéressée de l’intellectuel, — toute la responsabilité incombe bien à la jeunesse et si la culture n’en a pas sa part : la culture, ou du moins cette ombre, ce simulacre de culture qui n’évoque plus à l’esprit de tant de jeunes gens que les images des plus mornes corvées scolaires ou des loisirs sans grandeur d’une bourgeoisie déclinante, les images de la scoliose et du rachitisme, de la poussière et de l’ennui.
Ne crions pas trop vite à la barbarie en présence des accusations souvent puériles que porte la jeunesse contre la culture. N’oublions pas qu’il peut y avoir dans l’irruption brisante de forces neuves aux époques de grands bouleversements un principe de fécondité pour la culture elle-même. N’oublions pas que de grands mouvements spirituels, qui ont abouti en fin de compte à des créations extrêmement importantes de l’esprit, ont commencé par s’attaquer aux formes de pensée et d’art intérieurement inexistantes avec une fureur d’iconoclaste qui dut paraître aux contemporains imbécile et désastreuse. N’oublions pas enfin que l’un des hommes qui ont fait à la culture humaine l’apport le plus fécond et le plus irremplaçable, je veux dire Descartes, a mis au principe de sa pensée un acte de défiance « a priori » à l’égard de toutes les connaissances antérieurement acquises. Il peut y avoir dans la vigueur même avec laquelle des forces neuves affrontent les formes desséchées et pétrifiées d’une culture vieillissante la promesse d’heureuses métamorphoses, à la condition bien entendu que cette révolte porte en elle, et jusque dans des injustices peut être nécessaires, non pas la dangereuse folie d’un nihilisme sauvage, mais le respect de l’esprit qu’elle peut aider à se dégager de ses chaînes pour de nouvelles créations et de nouvelles métamorphoses.
Le respect manque à beaucoup de jeunes détracteurs de la culture. Du moins est-il bon de se demander quelles sont les origines de leur dégoût ou de leur ressentiment. La première de toutes et la plus générale me paraît facile à discerner : « ce qu’on reproche à la culture, c’est de n’avoir point su aider ceux qui en étaient les détenteurs à préserver le monde, la société, la patrie des convulsions presque mortelles où ou les voit aujourd’hui se débattre. Beaucoup de jeunes gens reprochent à la culture de n’avoir point d’utilité pratique. Ce reproche est grossier s’il est accepté littéralement, puisque c’est de n’être point pratique qui fait la raison d’être de la culture et sa dignité, et que son utilité est, si l’on ose dire, d’être inutile. Mais, comme il arrive, souvent, on peut découvrir sous une formule que sa maladresse fait absurde un sentiment trop fortement éprouvé pour n’avoir point quelque raison d’être. Il est certain que la culture doit aider l’homme à vivre en lui donnant une vie plus ample et plus profonde, c’est-à-dire plus complète ; il est certain que la culture dégénérée qui a été dispensée aux dernières générations, culture faite de scolastique et de dilettantisme, loin de les aider à vivre, les a détournées de la vie.
Grief très général encore, et peut-être assez discutable sous cette forme générale. Car la jeunesse d’aujourd’hui aurait tort de reprocher à la culture dont les trésors ont été assemblés par les générations antérieures de n’avoir pas suffi à mettre les générations actuelles en mesure de dominer les problèmes de ce temps. De même qu’il serait absurde de mépriser la raison parce qu’elle n’a pu nous assurer des progrès indéfinis sur une route facile et sans risques, — l’irrationalisme d’aujourd’hui n’est que le fruit de la déception d’un rationalisme très puéril — de même il serait absurde de mépriser la culture parce qu’elle n’est pas en mesure de dominer les désordres et les énigmes du monde actuel. La culture, ai-je dit, peut aider à vivre ; mais elle ne suffit pas à résoudre tous les problèmes de la vie, et même en ses moments de plus grande richesse, elle ne saurait dispenser ni d’invention, ni de création, ni de risque, ni d’aventure, en face d’un monde éternellement neuf, ceux-là même qu’elle nourrit et fortifie.
Mais ce grief se précise et se fonde plus solidement, à mesure qu’on le décompose en griefs plus particuliers. J’en noterai quelques-uns seulement, parmi ceux qui ont le plus d’importance. On peut reprocher à la culture, telle qu’elle a été dispensée aux hommes de notre temps, de ne les avoir nullement préparés à vivre dans des circonstances historiques exceptionnelles pourtant facilement prévisibles, de ne pas les avoir rattachées aux sources vivantes du passé et de ne pas leur avoir ouvert les voies inquiétantes et enivrantes de l’avenir, de n’avoir offert au grand nombre que des exercices purement scolaires, au petit nombre que des plaisirs d’amateurs ou d’érudits. On peut lui reprocher d’avoir cessé de rayonner dans la société toute entière dont elle eût dû constituer en même temps le foyer, la sève et le ciment, d’avoir été réservée à un petit nombre de privilégiés, d’avoir été une culture « de classe », une culture « bourgeoise ». On peut lui reprocher, enfin, le dédain ou la défiance qu’elle a montré à l’égard des vertus du corps et du caractère, de la santé et de la nature, de s’être enfermée dans les bibliothèques, d’avoir été l’ennemie de la vie physique. Si les grandes activités qui ont de nos jours séduit la jeunesse, le service civique et national, les luttes sociales, l’épanouissement physique dans la vie collective au grand air et le sport, ont paru si souvent être recherchées aux dépens des activités propres de l’esprit, n’est-ce pas parce que la culture les avait d’abord dédaignées, traitées en suspectes on en ennemies ? C’est un truisme de dire que la jeunesse se tourne vers la vie, comme la plante vers la lumière. Pour qu’elle se détournât de la culture, il suffisait qu’on fît l’erreur de lui présenter la culture au pôle opposé de la vie. Que l’on réconcilie la culture et la vie, et l’on réconciliera du même coup la jeunesse et la culture.
Réconciliation non pas totale sans doute. Il est normal qu’un antagonisme persiste entre ce qui, dans une nation, rassemble et résume le passé, les biens hérités, les connaissances transmises, et ce qui par nature se tourne vers le nouveau et le futur. La tension de cet antagonisme est elle-même féconde. Il faut que les frémissements de la vie et de l’impatience viennent troubler la richesse sommeillante de ce qui est acquis, il faut que les forces neuves sentent l’excitant des disciplines et l’obstacle du frein. Rien ne se conserve que par de constants afflux de vie. Rien ne progresse qu’en utilisant et en surmontant les apports antérieurs. La culture et la jeunesse ont chacune à faire vers l’autre la moitié du chemin.
Thierry MAULNIER, La Légion, 17, octobre 1942
Thierry Maulnier (1909-1988) : Né Jacques Talagrand, écrivain, essayiste, journaliste, dramatique. Très tôt engagé dans des cercles de droite, proche de l’Action française et du courant des non-conformistes des années 1930. Il écrivit des essais, participa à des revues, créa des hebdomadaires comme L’Insurgé (avec Jean-Pierre Maxence) et Combat (avec Jean de Fabrègues) dans lesquelles il aborde des enjeux politiques, sociaux, culturels.