Rapport présenté au Congrès international du Folklore par Paul Marc Sangnier
Lorsqu’en 1910 un instituteur de Westphalie, Richard Schirmann, créait dans son école la première Auberge de la Jeunesse, un de ses buts principaux était de permettre aux jeunes de toutes classes et de tous milieux de reprendre contact avec les vieilles traditions populaires de leur pays. Il jugeait en effet qu’
un des meilleurs moyens pour former une jeunesse saine et vigoureuse était de la retremper dans une vie simple, rustique, de lui faire comprendre et aimer le sol qu’elle foulait.
Depuis, l’idée de Ricard Schirmann s’est développée et, dans 22 pays, réunis ici, une « Entente internationale » dont « La Ligue française pour les Auberges de la Jeunesse » est le correspondant français, plus de 5 000 Auberges accueillent chaque année des milliers de jeunes gens et de jeunes filles.
Mais l’Auberge de la Jeunesse ne se contente pas de favoriser les rencontres des jeunes de tous les pays et de faciliter leurs voyages ; elle présente, du point de vue du folklore un intérêt unique et joue un rôle irremplaçable. Car, alors qu’il existe — et ce Congrès en est une preuve magnifique — des groupements qui s’intéressent à l’étude du folklore, c’est seulement dans les Auberges, ou presque, qu’on vit le folklore, qu’on le regarde, pour ainsi dire, du dedans. En général, lorsqu’on organise des manifestations de folklore, on le fait dans un but spectaculaire et instructif, que ce soit une exposition, une séance de chant et de danse, ou une reconstitution de quelque vieille demeure. À l’Auberge, tout cela, on le fait pour soi, pour s’amuser, pour son propre plaisir.
Ces quelques jeunes qui chantent, le soir, autour de l’âtre, dans un petit chalet de montagne, savent bien que personne n’entendra leur chanson ; ceux-là qui dansent dans la prairie savent bien que nul ne peut les voir ; et ils n’en chantent et n’en dansent qu’avec plus d’ardeur. Alors, le folklore cesse d’être une chose morte ; il ressuscite dans toute sa fraîcheur.
C’est, par exemple, un lieu commun de dire que les Français sont moins musiciens que les Allemands ou les Slaves ; et le fait est, hélas ! trop frappant pour quiconque entend côte à côte deux groupes de jeunes pris au hasard parmi des Français et des Allemands. Il n’y a pourtant aucune cause physique à ce fait ; au dix-huitième siècle, par exemple, il semble bien que la majorité des Français fût fort musicienne ; non, c’est uniquement une question de coutume, d’habitude. Si les Français chantent moins bien, c’est qu’ils chantent moins et sans discipline. Et là où l’école n’apporte qu’une solution partielle — car c’est justement le caractère de liberté et de spontanéité qui fait revivre le folklore — l’Auberge apporte le bon remède ; c’est de soi-même qu’on s’y livre à la tradition, avec cependant cette discipline, cet esprit de groupe indispensables.
On ne peut demander à l’Auberge de faire pour les instruments de musique ce qu’elle fait pour les chansons. Pourtant, nombreux sont déjà les usagers que l’on rencontre, portant une flûte ou une guitare (ces deux instruments sont ceux qui paraissent jouir de la plus grande faveur). Là encore, l’exemple allemand est frappant ; durant les quelques années d’après-guerre, c’est par centaines qu’on voyait les guitares en bandoulière, au point qu’un « wanderer » sur trois ou quatre en avait une. Si l’on ne peut songer a faire revivre de vieux instruments, trop encombrants définitivement morts, il faut noter tout de même la volonté tenace des Ecossais de conserver un instrument aussi incommode que la cornemuse, grâce à quoi on la rencontre dans toutes les Auberges de leur pays.
Mais il est temps de voir ce qu’a réalisé pratiquement la « Ligue française pour les Auberges de la Jeunesse » dans le sens du folklore.
En ce qui concerne la construction de nouvelles Auberges dans le style du pays, la question financière a empêché de réaliser beaucoup. Toutefois, la Ligue n’a jamais retenu de projets qui ne fussent conformes au plus pur style régional ; il est d’ailleurs à noter que les règlements mêmes de l’« Union internationale » prévoient que les Auberges doivent être construites dans cet esprit. De plus, chaque fois qu’il s’est agi de choisir un local ou de créer une Auberge, la Ligue a tenu compte de ce facteur, en particulier pour les chalets de montagne. Pour les coutumes et les danses, il est plus difficile d’apprécier l’action rénovatrice des Auberges. C’est surtout en permettant aux jeunes de connaître de plus près les mœurs de nos campagnes qu’elles ont servi.
Mais, à l’étranger, il est très courant de danser devant l’Auberge de vieilles danses populaires et, malheureusement, les quelques danses que l’on exécute dans nos Auberges sont faites à l’instigation des visiteurs étrangers. Mais une réaction se dessine déjà.
Pour le costume, c’est encore a l’étranger que nous emprunterons nos exemples. On rencontre très souvent de jeunes Français vêtus d’un kilt écossais ou d’une culotte tyrolienne en peau — si commode pour la marche. Si une renaissance complète du costume régional paraît difficile en France, il semble toutefois que les jeunes s’intéressent aux costumes locaux dont on décore parfois les Auberges, et qu’en tout cas ils en apprécient fort certaines parties, comme les espadrilles et le béret du Pays basque, le foulard rapporté de la Camargue, ou le couteau de Nontron.
Mais c’est surtout pour le chant, dont nous parlions au début, que l’œuvre des Auberges de la Jeunesse est la plus intense. Si les jeunes rapportent parfois un conte, une histoire entendus dans une campagne, ou même une recette de cuisine, ou une façon de faire les nœuds, ce qu’ils apprennent et répandent le plus lâchement, c’est une chanson.
Il est difficile de présenter une statistique des chansons chantées dans les Auberges. On peut pourtant affirmer que les chansons dites « à la mode » n’y sont pas chantées, sinon par des isolés, qu’on y chante donc presque exclusivement de vieux chants français.
Voici, à ce propos, le rapport que nous a adressé l’animateur du groupe musical de la « Ligue française pour les Auberges de la Jeunesse », William Lemit :
« Les Auberges de la Jeunesse sont un terrain particulièrement propice à une renaissance du folklore musical français (renaissance est bien le mot, puisqu’il s’agit de jeunes gens et de jeunes filles habitant pour la plupart les villes et n ayant aucun lien avec ce qu’on appelle “le terroir”).
« On a plaisir à constater qu’un répertoire intéressant s’y est déjà constitué, composé en grande partie de chants populaires français, et que le goût du chant s’y développe de plus en plus.
« Cependant, si l’on veut arriver à une action réellement bienfaisante, il reste un gros effort à faire en ce qui concerne la manière de chanter aussi bien que le répertoire.
« Malgré un progrès certain, on rencontre encore très souvent un manque total de soin dans le chant, manque de soin qui se manifeste par le besoin de brailler, l’incapacité totale d’écouter les autres chanteurs et d’essayer de régler sa propre voix sur la leur, d’où manque de discipline et d’ensemble, absence de nuances ; d’autre part, chansons mal connues et, par suite, déformation des textes, des mélodies et des rythmes. Il est à noter que ces déformations se font presque toujours dans le sens de la paresse. Exemple : une croche pointée, suivie d’une double croche, qui devient un triolet d’une noire et d’une croche, ou deux croches.
« Tout cela témoigne d’une absence d’attention et de tension pendant le chant, d’une attitude indolente et inconsciente. C’est évidemment la conséquence ce l’absence, en France, d’une ambiance et d’une tradition musicales, telles qu’elles existent ailleurs, dans la famille, à l’école et dans tous les milieux, et ce n’est pas en un jour, ni même en plusieurs années qu’il sera possible de créer dans les Auberges une telle ambiance et une telle tradition.
« Comment peut-on y travailler ? Une campagne de grande envergure risque d’être superficielle et inefficace, et nous avons plus de confiance dans une propagande par l’exemple, une sorte de noyautage qu’il faudrait encourager et provoquer. Pensons a ce que nous devons déjà aux contacts avec les étrangers. Il faudrait avoir la possibilité de conseiller et de renseigner les bonnes volontés et de les aider a acquérir les connaissances qui leur manquent, car, si le solfège et les principes de la musique étaient plus connus, les déformations seraient moins fréquentes et l’enrichissement du répertoire plus facile.
« Puisqu’il est question du répertoire, nous pensons qu’il pourrait être augmenté d’un très grand nombre de chants populaires, a choisir en tenant compte de l’atmosphère des Auberges, c’est-à-dire en évitant la trivialité comme la puérilité. Quant à la sentimentalité, il serait peut-être imprudent de vouloir la chasser complètement, car elle risquerait de reparaître sous des formes moins heureuses.
« Nous sommes d’avis, par contre, d’éviter le plus possible les adaptations, que souvent rien ne justifie, et qui sont parfois très mal venues prosodiquement, sans intérêt et d’un style ‘folklore’ très factice. Les adaptations de chansons étrangères sont souvent accompagnées de déformations de la mélodie et du rythme, par suite du déplacement des accents. En fait, il vaudrait mieux faire l’effort de chanter toutes les chansons étrangères dans la langue originale. C’est souvent difficile, mais c’est la seule manière d’en profiter vraiment.
« Enfin, il est surprenant et regrettable que notre répertoire comprenne si peu de créations entièrement originales. Parmi tous ceux et celles qui passent dans les auberges les meilleures heures de leur existence, il en est certainement beaucoup qui seraient capables d’exprimer leurs joies par des poèmes et des mélodies simples, sincères et vivants.
« Le chant a plusieurs voix offre, sinon a tous, du moins à un certain nombre, de grandes possibilités, mais la littérature existante ne correspond pas exactement aux besoins. Il en est de même pour les instruments tels que guitare, flûte douce, harmonica, accordéon, dont il faut encourager l’usage.” »
Comme liste de chants, je pourrais citer celle des chants étudiés par la chorale des Auberges durant cet hiver, sur laquelle nous relevons à part deux chants étrangers, l’un napolitain, l’autre allemand :
Aque los Mountagnos (Pyrénées) ;
Dis-moi m’amour la caille (Provence) ;
Sont trois jeunes garçons (Vivarais) ;
Au port du Havre (normand) ;
Gentil Galant de France (quinzième siècle).
Il existe d’ailleurs des recueils de chants ne contenant que des chansons dans cet esprit et faits par des jeunes eux-mêmes.
Aussi je termine en insistant sur le caractère de discipline et de spontanéité libre et joyeuse, la meilleure garantie de la vie du folklore dans les Auberges de la Jeunesse.
L’éveil du Peuple, 29/08/1937
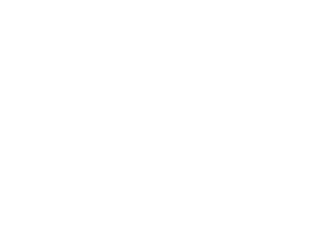
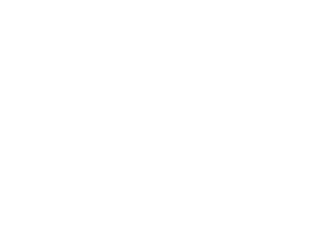
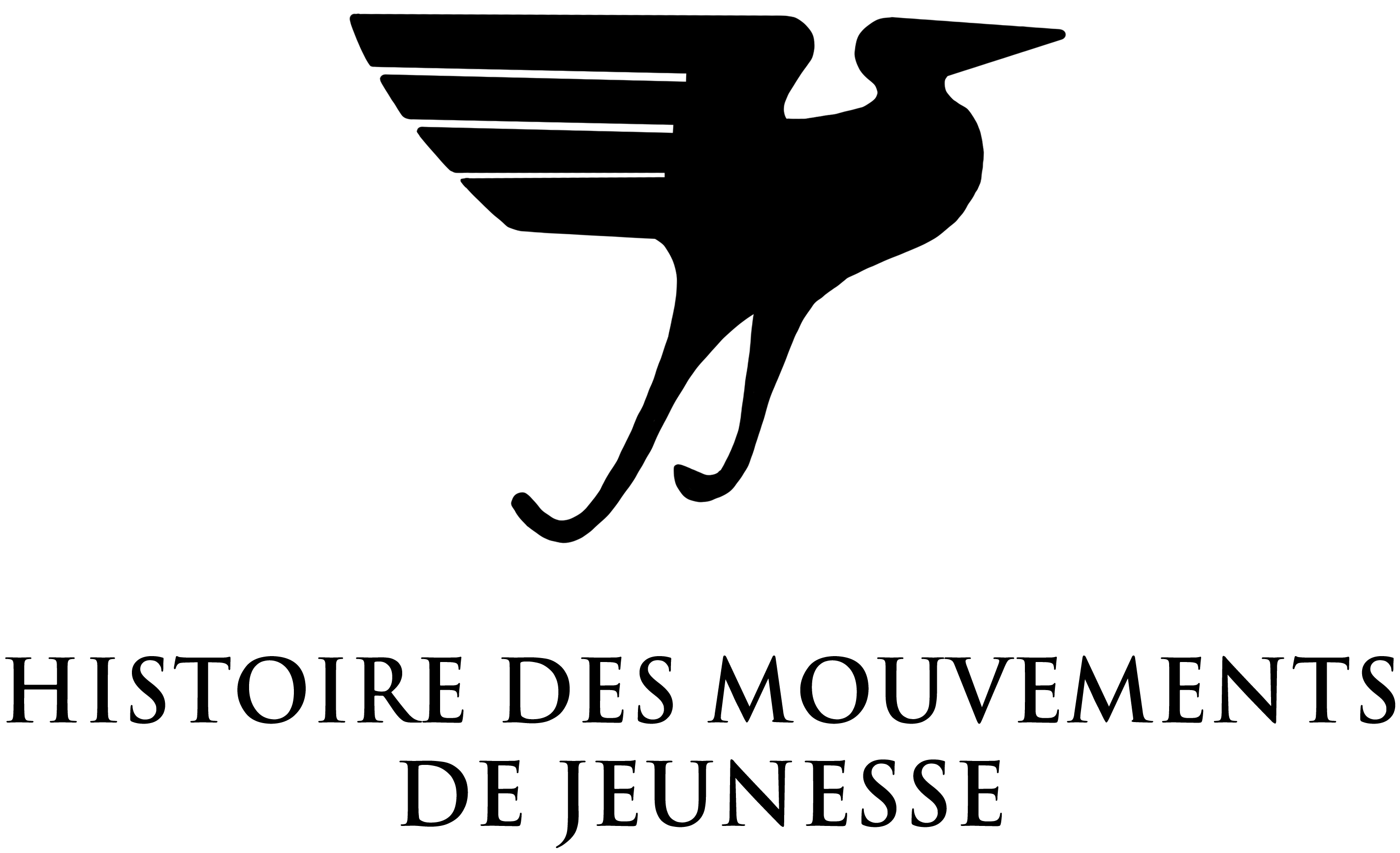
Les auberges de jeunesse ont été d’une grande importance pour le développement du tourisme pédestre au sens large du terme.
Il existait déjà vers 1906 les auberges scolaires en Prusse, Belgique et Luxembourg le long des sentiers balises comme ceux de l’Eifelverein.
Les jeunes pouvaient loger dans les villages dans ces auberges scolaires gères par des parents aubergiste.
En 1985 fut créé à Vienne le mouvement international de tourisme social les Amis de la Nature.
Permettre à la classe ouvrière de découvrir librement la nature, avoir accès à la montagne.
Ce mouvement international s’est rependu considérablement avant la seconde guerre mondiale suite aux congés payés.
On oublie trop souvent que le bénévolat à permis de construire des refuges, maisons et auberges amis de la nature.
Le tout réalisé bénévolement comme la gestion et le gardiennage des maisons AN.
Celles ci étaient considérés comme maison de vacances pour les bénévoles et utilisateurs.
Au niveau des auberges de jeunesse, il y eu la période des clubs ajistes jusque 1970 et 1980.
La randonnée pédestre était le seul moyen de déplacement à cette époque des annees 1930 et après 1945.
Le développement des chemins de fer, l’apparition des congés payés, les clubs alpins et les touring clubs amenant des adeptes de la montagne, soit les grimpeurs et les excursionnistes.
Début du 20 ème siècle beaucoup d’ associations d’excursionnistes se créent même fin 19 ème siècle.
Le scoutisme amenant les jeunes ou excursionnistes de parcourir les sentiers non encore balises dans les montagnes et les régions méconnues.
Un nom pionnier de la rando est Jean Loiseau.
Nous n’en dirons pas plus.
Chacun pouvant s’informer librement grâce à ce site et internet.
Qui pense ranfo, pense les sentiers de grade randonnée.
Pour l’histoire au sens large du terme, il a lieu de consulter les bibliothèques.
Amitiés pédestres de Belgique.
Jean Pierre Englebert.