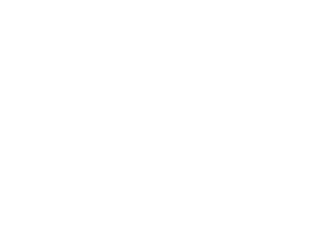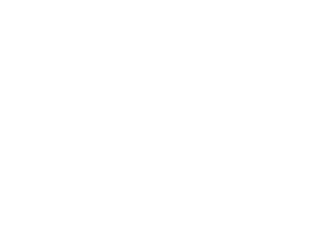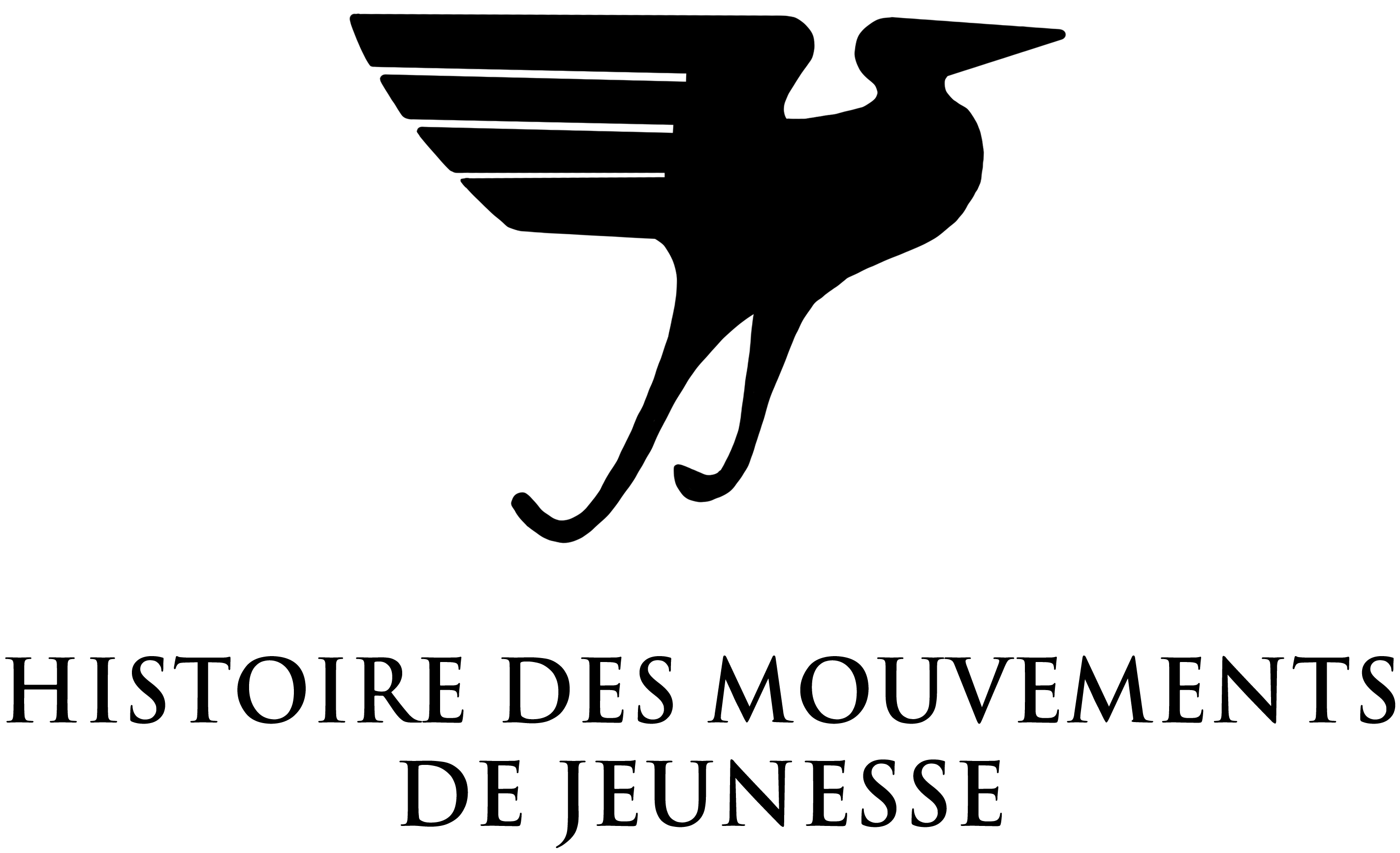MATHILDE, HORS DE L’EMPRISE DU TEMPS
On a vu qu’un visage féminin transparaissait au milieu des pétales de la mystérieuse fleur. Pour Henri, ce visage ne tardera pas à avoir un nom. Chez son grand-père maternel, il fait la connaissance du poète Klingsohr — à ne pas confondre avec le magicien du Parzival de Wolfram Von Eschenbach — et surtout de sa ravissante fille, Mathilde. Précisons tout de suite que ce prénom est la contraction des termes germaniques magan (megin à l’époque viking, le pouvoir surnaturel dévolu à un être) et hild (« combattante »)[1], ce qui tend à prouver qu’une telle charmante personne porte en elle ce supra-humain dont est issue la Fleur Bleue. Et c’est précisément cela que Novalis nous donne à comprendre lorsqu’il fait dire à Henri « Vous, chère Mathilde, je ne saurais vous nommer que saphir pur et précieux. Vous êtes claire et transparente comme le ciel, et vous illuminez toute chose de la manière la plus douce »[2]. Comprenons que Mathilde n’est pas la fleur en question, mais que ce végétal magique ou, plus exactement, ce qu’il représente illumine — pareillement qu’un saphir — la jeune fille. Cette dernière, après sa disparition terrestre vit sur un autre plan par ce même pouvoir de la fleur. C’est pourquoi, à la fin du récit, la jeune fille se manifeste à Henri « à travers un long rayon qui perçait la ramure, et il vit à l’intérieur […] une miraculeuse splendeur qu’on ne saurait décrire et encore moins représenter par les couleurs de l’art. Les figures y étaient d’une extraordinaire finesse et il en émanait un plaisir et une joie intérieurs, oui, véritablement une béatitude céleste qu’on pouvait contempler partout, et si intense que même les objets inertes, les vases, les colonnades, les tapis et autres ornements, bref toutes les choses qu’on pouvait y voir donnaient l’impression, non pas d’avoir été façonnées, mais d’être comme des plantes pleines de sève qui auraient poussé là […] Allant et venant parmi ces splendeurs, c’étaient les plus belles, les plus parfaites formes humaines, et qui avaient entre elles des rapports d’affection et de sympathie inconcevables et d’une grâce irrésistible »[3].

Par cette vision, « le supplice atroce d’une perte indicible, l’affreux et morne vide, la terrestre impuissance, tout s’en était allé » et Henri « se retrouvait au milieu d’un monde entier de nouveau et plein de signification […] et tout, à présent, lui semblait à la fois plus familier et plus prophétique qu’auparavant ; ainsi voyait-il désormais la mort comme une supérieure révélation de la vie »[4]. On ne sait si ce lieu véritablement apollinien est l’au-delà ou sur un autre plan dimensionnel en faisant songer au « Centre suprême » (au commencement du cycle). Mais, comme nous allons le découvrir, les deux se confondent : ce que nous dénommons la mort n’est autre, pour Novalis — il rejoint en cela un concept essentiel de la Tradition — qu’un état supérieur d’existence hors des effets destructeurs du temps. Comme en témoignent les esquisses des chapitres à venir de ce roman inachevé, Mathilde, disparue, se révèlera sous d’autres identités. Elle sera Cyané, en apparence jeune paysanne qui, venant auprès d’Henri juste après sa vision de la supposée défunte, lui dit qu’elle le connaît « de bien loin dans le vieux temps ; même ma mère de jadis me parlait déjà tout le temps de toi à l’époque ». Cyané, en parlant de sa « mère de jadis », fait allusion à une existence antérieure. Ce qu’elle confirme en disant qu’elle « est sortie de la tombe » et d’ajouter « Sinon, comment pourrait-je vivre »[5]. Paroles que l’on pourrait interpréter comme une croyance en la métempsychose de la part de Novalis, mais il serait plus juste d’y voir l’expression du sentiment qu’une seule existence est insuffisante pour parvenir à réaliser notre identité complète. Mathilde s’est manifestée à Henri depuis un lieu où le temps est aboli, mais elle a pris corps sous l’apparence de Cyané dans le monde, toujours soumis aux heures, où Henri poursuit son existence. Encore convient-il de préciser que, pour préparer ce dernier à la perception qu’une vie supérieure outrepasse le règne de Chronos[6] dont dépend l’humaine condition, Cyané conduit notre héros à un homme d’un certain âge, prénommé Sylvestre, à la fois médecin et jardinier. On sait qu’Asklépios (Esculape) est fils d’Apollon désigné comme le « guérisseur ». De plus, nous découvrons que Sylvestre vit « entouré des plantes les plus rares » dans « un jardin d’agrément absolument délicieux »[7] et cela fait songer au jardin d’Apollon, domaine principal de l’Hyperborée. Il se trouve que Sylvestre, à l’époque déjà d’un âge avancé, a connu le père d’Henri alors qu’il était fort jeune. Ce médecin jardinier, on le voit, n’est plus soumis aux exigences du temps. Le père d’Henri se souvenait de lui en disant qu’ « il se trouvait comme chez soi au plus profond des ères païennes, et il y avait une ferveur incroyable dans sa nostalgie d’un retour dans le temps jusqu’à l’antiquité la plus reculée »[8]. C’est ce même Sylvestre qui, dans le rêve du père, proclame que la fleur bleue est « la Merveille du Monde ».
LA CITÉ AU NORD DU MONDE
Mathilde est Cyané mais, dans les fragments de ce qui devait être la suite du récit, elle se révèlera aussi comme étant Edda (« Aïeule »), figure de la mythologie germanique symbolisant la « Connaissance spirituelle et initiatique » transmise à travers la poésie[9]. Et, précisément, Henri est un poète. Cela signifie que la fleur bleue, dont Mathilde semble une émanation, se confond avec Edda. En conséquence, la fleur miraculeuse manifeste une connaissance « Aïeule », autrement dit « ancestrale », d’une prodigieuse ancienneté. Elle symbolise ainsi la Tradition primordiale, le savoir indissociable du « Centre suprême ». Ce « Centre », qu’on le nomme Hyperborée ou Thulé, intervient dans un récit d’une rare complexité, car entrelaçant symboles, mythes et allégorie, que rapporte Klingsohr.
Il est d’abord question d’une cité merveilleuse aux remparts transparents reflétés par la glace recouvrant un fleuve. On ne nous localise pas ce lieu mais il se trouve dans la féerie blanche du gel et du givre. Là demeure un souverain nommé Arctur. On songe évidemment au roi légendaire de la Table Ronde et à la racine arct (ou art), évoquant l’ours, de ces noms renvoient aux deux constellations indiquant le Nord et le Pôle. Et, outre cela, « Sur sa tête étincelait la Couronne Boréale »[10]. Semblablement à la Vénus de la mythologie germanique, la fille de ce souverain est appelée Freya. Une façon pour Novalis d’inclure la mythologie germanique tout en indiquant la localisation nordique de ce royaume. Du reste, c’est bien en prenant une direction septentrionale que des personnages vont parvenir à cette merveilleuse cité. Il est en effet question d’une tige de fer qui, comme l’aiguille aimantée d’une boussole, « se tournait vers le Nord »[11]. Le souffle d’un être symbolisant l’Imagination[12], va la transformer en « un serpent qui tout à coup, alors, se mordit la queue »[13]. Il est aisé de comprendre que, mentionnant à plusieurs reprises l’Âge d’Or, notre auteur a connaissance de la doctrine du cycle et symbolise l’achèvement — la clôture — de l’Âge de Fer[14] par l’image de cet ouroboros. Et c’est ce même serpent de fer qui va guider vers le Nord[15] et la merveilleuse cité l’Imagination ainsi qu’Éros, futur époux de Freya. La fin de l’Âge de Fer reconduit donc au royaume fortement évocateur de l’Hyperborée.
Bientôt, un personnage prénommé Sophie — et, comme telle, suivant sa signification en grec, personnifiant la Sagesse — vient dire que « Le grand Mystère à tous est révélé […] Le monde nouveau s’est engendré de nos douleurs, et c’est en se dissolvant dans les larmes que les cendres sont devenues l’élixir de vie éternelle ». Il advient alors qu’ « Un printemps vigoureux avait pris puissamment possession de la terre […] Le royal château fort rayonnait, rayonnant sur la mer avec magnificence ; et là-haut, aux créneaux, se tenait le roi en grand apparat […] Le jet d’eau dans le parc jaillissait, redevenu d’eau vive »[16]. L’hiver qui enserrait ce monde a disparu car, à l’évidence, l’Âge d’Or est de retour. Ce que semble manifester le fait que « l’on vit bientôt autour de chaque tête un anneau de lumière tandis qu’un lien éblouissant fusait, passant par-dessus la ville et par-dessus la mer et tout autour de la terre, encerclant tout pour la célébration d’une éternelle Fête du Printemps »[17]. Comme l’annonçait un jeune poète (duplication d’Henri dans une vie passée) en s’accompagnant du luth, arrive enfin « le terme des tribulations et des désolations, le renouveau de la nature retrouvant sa jeunesse, et la perpétuation éternelle de l’Âge d’Or revenu »[18].
Pour Novalis, toutes les épreuves du passé nous préparent au retour triomphal et définitif de l’Âge primordial. D’où le fait que la notion d’éternité revienne comme un leitmotiv. Les êtres destinés à préparer cette venue ne meurent qu’en apparence car ils possèdent une corporéité de nature non tangible qu’évoque l’auteur. En effet, au moment du renouveau, un personnage est ressuscité par un processus où intervient la personnification de l’or – métal, donc, de l’Âge premier – et « si belle, si imposante que fût sa stature, il n’en semblait pas moins que son corps tout entier consistât en un fluide extrêmement subtil et d’une mobilité infinie, où chaque impression se traduisait par toutes sortes de mouvements exquis et d’un charme extraordinaire »[19]. On comprend, alors, quelle est la nature corporelle des êtres entrevus par Henri dans le rayon de lumière.
L’ESPRIT WANDERVÖGEL ET LA QUÊTE DE LA FLEUR BLEUE
Novalis et son œuvre ont fortement marqué de nombreuses générations de jeunes Allemands au XIXe s., et son influence littéraire a largement dépassé les frontières de son pays. C’est de là que nous vient l’expression actuelle en langue française, certes dévoyée de son sens profond, « être fleur bleue », pour désigner un « sentimental ». Il est remarquable qu’un siècle après le décès de Novalis, émergea en Allemagne un mouvement de jeunesse issu du romantisme, qui se revendiquait de sa pensée poétique, de ses visions oniriques, que l’on appelle le mouvement Wandervogel[20] (que l’on traduira par « Oiseau Migrateur », ou « Oiseau Voyageur »). Ce mouvement est né exactement en 1897 à Steglitz, une petite ville de la banlieue de Berlin, à l’initiative de deux jeunes enseignants de lycée, Karl Fischer et Hermann Hoffmann. D’une poignée qu’ils étaient au début, le mouvement s’étendit en groupes, ou « Bund », de plus en plus nombreux à travers toute l’Allemagne, passant de quelques dizaines de milliers de membres à l’orée de la Première guerre mondiale, et finissant par compter près d’un million de membres en 1930. Le mouvement s’était aussi développé parallèlement en Autriche, et très tôt en Suisse (probablement dès 1897). Il tenta de prendre racine en France à cette époque, mais cela lui fut refusé par l’État qui voyait d’un mauvais œil l’irruption d’un mouvement de jeunesse qui se voulait indépendant, contrôlé ni par l’État, ni par l’Église, ni par aucun système d’adulte. Le scoutisme put par contre s’y implanter, mais au prix d’une grande concession : que les groupes soient inconditionnellement contrôlés par une institution étatique ou religieuse, ce qui est encore en grande partie le cas. Ce n’est que dans les dernières décennies que les Wandervögel ont pu s’implanter en France.

L’idée des fondateurs du Wandervogel était — et reste encore la base du mouvement de nos jours — de sortir la jeunesse de la « culture de mort » du monde des villes et de l’univers mental qui va avec, des fausses valeurs de la bourgeoisie. Comme un peu partout en Europe, nous étions en effet en pleine époque de destruction du monde traditionnel sous les rouages d’une industrialisation, d’une urbanisation et d’un exode rural galopants, dont le corolaire était l’embourgeoisement progressif et profond de la société dans son entier. Ce qu’on entend ici par « embourgeoisement » peut-être résumé par les termes « matérialisme » et ses conséquences : le consumérisme, la futilité et l’aliénation des vies dans la dictature du fétichisme de la marchandise. Dès le départ, les “moyens” choisis pour arriver à en sortir les jeunes furent la randonnée dans la nature sauvage, au contact avec le monde rural[21], la musique et les chants traditionnels[22], la poésie, l’hygiène de vie[23], la danse traditionnelle, la défense de la nature et l’entretien de l’esprit de communauté organique entre les camarades du mouvement. C’est par tout cet ensemble d’activités que devait pouvoir ré-émerger dans la jeunesse, désembrumée des miasmes mentaux de la société moderne, le « ressouvenir » d’un Âge d’Or mythique, dont la « Sehnsucht » plus ou moins consciente est probablement ce qu’ont en commun tous ces jeunes gens qui ont, un jour, décidé de rentrer dans ce mouvement. La notion de Sehnsucht, au cœur de l’univers mental wandervogel, revêt en langue allemande une signification complexe que l’on ne peut traduire en français simplement par la « nostalgie », laquelle confine à une forme de tristesse, de souffrance (« algie »). La Sehnsucht est plutôt à entendre comme une aspiration, une attraction, un besoin profond (Sucht) de (re)voir (du verbe sehen). Cela se manifeste chez les Wandervögel comme une nécessité, une tension mentale visant à revoir, faire ré-émerger intérieurement — et par extension dans la communauté — un monde idéal, celui exprimé par Novalis autour de sa Fleur Bleue qui nous avons développé dans les chapitres précédents, qui n’est ni plus moins que la résurgence de l’Âge d’Or des mythes européens. Dès la première page d’Henri d’Ofterdingen, Novalis fait dire au narrateur : « Un jour, j’ai entendu parler des époques primitives du monde quand les animaux, les arbres et les rochers conversaient avec les hommes ; eh bien ! il me semble qu’ils vont commencer à chaque instant, et que moi je vais comprendre tout ce qu’ils me diront… » C’est précisément là même que réside le point d’attraction intérieure du Wandervogel, dont la clé est l’expérience subtile de la nature permettant de ré-enchanter sa conscience à la source de temps primordiaux mythiques.
Cette expérience subtile avec la nature passe d’abord par « ne faire qu’un avec elle », comme l’exprime lui-même Novalis dans ses correspondances avec Madame de Staël (publiées dans de l’Allemagne, 1810). Il y distingue ceux qui ne font que « regarder » et s’extasier sans grand entendement de la nature, de ceux qui « voient » la nature, qui ont la démarche subtile que revendique le Wandervogel : « L’homme est avec la nature, dit Novalis, dans des relations presque aussi variées, presque aussi inconcevables que celles qu’il entretient avec ses semblables, et comme elle se met à la portée des enfants, et se complaît avec leurs simples cœurs, de même elle se montre sublime aux esprits élevés, et divine aux êtres divins. L’amour de la nature prend diverses formes, et tandis qu’elle n’excite dans les uns que la joie et la volonté, elle inspire aux autres la religion la plus pieuse, celle qui donne à toute la vie une direction et un appui. Déjà chez les peuples anciens, il y avait des âmes sérieuses pour qui l’univers était l’image de la Divinité, et d’autres qui se croyaient seulement invitées au festin qu’elle donne : l’air n’était, pour ces convives de l’existence, qu’une boisson rafraîchissante ; les étoiles, que des flambeaux qui présidaient aux danses pendant la nuit ; et les plantes et les animaux, que les magnifiques apprêts d’un splendide repas : la nature ne s’offrait pas à leurs yeux comme un temple majestueux et tranquille, mais comme le théâtre brillant de fêtes toujours nouvelles. » Il met ainsi en avant la démarche de « l’imagination de l’artiste [qui] osa l’interroger [la nature], et l’âge d’or parut renaître à l’aide de la pensée ». Il conclut sur ce conseil que fait sien le Wandervogel : « Il faut, pour connaître la nature, devenir un avec elle. Une vie poétique et recueillie, une âme sainte et religieuse, toute la force et toute la fleur de l’existence humaine, sont nécessaires pour la comprendre, et le véritable observateur est celui qui sait découvrir l’analogie de cette nature avec l’homme, et celle de l’homme avec le ciel. »
Les Wandervögel nous livrent cette « obsession mentale » de la quête de l’état d’Âge d’Or à travers les nombreux poèmes et chants qu’ils ont composés. Y revient comme un leitmotiv cette notion de « Wanderung » (cheminement, pérégrination, randonnée) d’une vie durant, à travers des contrées sauvages, non souillées par l’humain, qui, tel un chemin initiatique, permet d’approcher la sublime « Fleur Bleue », l’enchantement dans l’éternité de l’Âge d’Or.
On retrouve déjà très tôt dans l’œuvre littéraire des Wandervögel cette aspiration à un monde idéal, dont la musique, aussi discrète qu’est frêle la « fine Fleur Bleue », résonne à l’oreille du pèlerin en quête du Pèlerin entre deux mondes de Walter Flex[24], écrit pendant la Première guerre mondiale, dont est issu le chant emblématique des Wandervögel « Des Oies sauvages vers le Nord… ». La thématique de la Fleur Bleue se retrouve explicitement dans de nombreux chants des Wandervögel, avec des textes « à clés », comportant très souvent des métaphores énigmatiques qui ne sont pas sans rappeler le style de Novalis. Parmi ceux qui sont encore actuellement chantés, nous trouvons notamment le « Wir wollen zu Land ausfahren », composé il y a un peu moins d’un siècle. Là, il ne s’agit pas de bêtement randonner, comme la plupart des gens le fond maintenant, mais de pérégriner avec le filtre spécial des Wandervögel, pour lesquels la nature est un temple à ciel ouvert. Dans ce chant, la Fleur Bleue ne se trouve qu’au bout d’une quête difficile où il s’agit de (re)plonger dans le tréfonds des contrées sauvages, indemnes de pollutions humaines, des contrées qu’il faut voir comme à la fois intérieures (mentales) et extérieures (naturelles), où l’on retrouve aussi la notion de montagne (polaire) et de forêt (primordiale) qui occultent un monde enchanté, et aussi celle des « eaux principielles » porteuses de toute sagesse et de toute potentialité magique[25] :
Nous voulons partir dans nos campagnes,
Bien loin à travers champs.
L’appel des cimes nous gagne,
Leur clarté nous attend.
Nous voulons écouter où rugissent les bourrasques,
Et découvrir ce que les montagnes masquent,
/Vers le vaste monde, en avant ! / (bis)
Là, des eaux inconnues surgissent
Tels des sages guidant nos pas.
Nous marchons dans la liesse,
Chantant de vieux exploits.
Et notre feu crépite en un lieu magnifique,
Nous nous régalons d’une nature prolifique.
/Les flammes transportent notre joie./ (bis)
Se pose sur la vallée profonde,
Le voile calme de la nuit.
Les elfes s’éveillent à notre monde,
Lorsque la lune luit.
La forêt retient les pas et les murmures,
Elle entend et voit maintes magiques créatures,
/Qui vibrent avec nous dans la nuit./ (bis)
Le fond de la forêt abrite
La fine fleur d’azur,
La fleur qui se mérite.
Cheminons le coeur pur !
Dans le murmure des fleuves et le bruissement des arbres,
Qui veut trouver la fleur bleue se doit d’être
/Un Oiseau Migrateur./ (bis)
(Wir wollen zu Land ausfahren, texte original allemand de Hjalmar Kurtzleb, adaptation française d’Arnvald du Bessin).
Ce chant appelle à cheminer « par delà les monts lointains, s’élevant vers les clairs sommets de la solitude » , car chacun est remis face à lui-même au bout du chemin initiatique, dans une solitude à entendre non pas comme une détresse, mais au contraire comme une allusion à l’unité intérieure retrouvée, cette même solitude intérieure remplissant de félicité que confère la découverte de la Fleur Bleue.
Par ailleurs, dans le chant « Wenn hell die goldne Sonne lacht », la notion d’éternité se joint à la découverte de la Fleur Bleue :
Quand le clair soleil me sourit,
Je m’en vais à cent lieues,
Là où, magnifique, elle fleurit,
La belle et fine fleur bleue.
/J’arpente de vallées en sommets
Au coeur de nos campagnes.
S’il me venait de la trouver,
Qu’l’éternité me gagne !/ (bis)
Aux oiseaux des bois, dans ma quête,
En vain j’ai demandé :
« Où trouve-t-on cette fleurette ? »
Ils n’ont rien révélé.
/Et ainsi s’enchaînent les lieues,
S’émoussent mes espoirs.
Cette unique et splendide fleur bleue
Fleurit bien quelque part./ (bis)
Un jour, je vis la chance briller
Dans les yeux d’une jeune fille.
« Adieu, il me faut m’en aller.
Le temps me presse la belle. »
/Quand le clair soleil me sourit,
Je m’en vais à cent lieues,
Là où, magnifique, elle fleurit,
La belle et fine fleur bleue./ (bis)
(adaptation française d’Arnvald du Bessin).
 Puisque la notion de Fleur Bleue nous ramène à celle de Pôle, de terre de l’Âge d’Or, il n’est pas étonnant que l’on retrouve aussi fréquemment la référence à la terre mythique primordiale de Thulé dans les chants du Wandervogel, comme dans « Es war ein König in Thule » (« C’était un roi à Thulé ») repris sur un poème de Goethe. Pas étonnante non plus cette référence fréquente au Nord, comme avec les « Oiseaux Sauvages », mais aussi « Frühling dringt in der Norden » (« Le printemps surgit dans le Nord »). Pas étonnantes non plus ces allusions fréquentes à l’émergence à venir d’un nouveau printemps que l’on dirait apollinien , qui résonne à l’unisson de la devise du Wandervogel « Devenir mûr et rester pur », ce que sous-tend la quête de la Fleur Bleue.
Puisque la notion de Fleur Bleue nous ramène à celle de Pôle, de terre de l’Âge d’Or, il n’est pas étonnant que l’on retrouve aussi fréquemment la référence à la terre mythique primordiale de Thulé dans les chants du Wandervogel, comme dans « Es war ein König in Thule » (« C’était un roi à Thulé ») repris sur un poème de Goethe. Pas étonnante non plus cette référence fréquente au Nord, comme avec les « Oiseaux Sauvages », mais aussi « Frühling dringt in der Norden » (« Le printemps surgit dans le Nord »). Pas étonnantes non plus ces allusions fréquentes à l’émergence à venir d’un nouveau printemps que l’on dirait apollinien , qui résonne à l’unisson de la devise du Wandervogel « Devenir mûr et rester pur », ce que sous-tend la quête de la Fleur Bleue.
Pour compléter le panorama de la référence à la Fleur Bleue dans l’univers du mouvement Wandervogel, notons qu’elle revient fréquemment dans son iconographie, figurant par exemple comme emblème des Fahrenden Gesellen, un des plus anciens groupes Wandervogel encore actif — ayant célébré son siècle d’existence en 2009 – sous la forme du bleuet. Cette fleur blasonne leurs étendards d’or et d’azur, et leurs chemises, parfois accompagnées (voir emblème au bleuet des Fahrenden Gesellen, pages précédentes) de l’épée du chevalier en quête et du violon, remplaçant le luth, évocateur de chant, donc de poésie, le tout résumant à merveille l’univers mental du Wandervogel.
Arnvald du Bessin, La Maove, 91, été 2014
[1] Ce qui explique le prénom Mahaut comme variante de Mathilde.
[2] Ibid., p. 150.
[3] Ibid., p. 217.
[4] Ibid., p. 218.
[5] Ibid., p. 221.
[6] Divinité grecque du temps.
[7] Ibid., p. 222.
[8] Ibid., p. 28.
[9] Selon Robert-Jacques Thibaud, Dictionnaire de Mythologie et de Symbolique Nordique et Germanique, Éditions Dervy, Paris, 1997, p. 114.
[10] Ibid., p. 190.
[11] Ibid., p. 174.
[12] Selon Chantal Foucrier dans son étude Le Mythe littéraire de l’Atlantide, 1800-1939. Éditions Ellug, Grenoble 2004, p. 289.
[13] Henri d’Ofterdingen, op. cit., p. 175.
[14] Le dernier âge mythique du cycle en contenant quatre, décrit par les anciens Grecs, mais aussi dans de nombreuses autre traditions indo-européennes, appelé Kali-Yuga, ou « Âge sombre » dans la tradition indo-aryenne, bouddhiste. Il fait suite aux Âges d’Or, d’Argent et de Bronze, à ne pas confondre avec les âges archéologiques (« DU bronze », « DU fer »).
[15] Ibid., p. 175 et 179.
[16] Ibid., p. 202, 203 et 204.
[17] Ibid., p. 206.
[18] Ibid., p. 67 et 68.
[19] Ibid., p. 202.
[20] Le nom fondateur fut donné à Steglitz à l’initiative de Karl Fischer en 1901, soit exactement un siècle après le décès de Novalis. Ce fut le premier mouvement de jeunesse d’ampleur du monde moderne. En effet, le scoutisme n’a fait son apparition qu’une dizaine d’année plus tard, sous l’égide du Britannique Baden Powell, et visiblement indépendamment de l’idée wandervogel, puisque le scoutisme se basait dès le départ comme acteur pour et dans la société, alors que le Wandervogel se voyait hors de la société du temps, et ne voyait comme autre issue que de la réformer radicalement.
[21] Ils créèrent les communautés agricoles dites « Artamannen » à partir des années 1920 dans le but de maintenir dans le monde agricole les valeurs traditionnelles, l’identité ethno-culturelle, un haut niveau de qualité de production (fondant à l’occasion la notion d’agriculture dite « biologique ») et de le protéger du mercantilisme (créant les premiers réseaux dits « localistes »).
[22] C’est ainsi que les Wandervögel ont fait œuvre de sauvegarde de tout le corpus des chants traditionnels allemands que l’on entonne encore de nos jours.
[23] L’interdiction du tabac et de l’alcool furent dans les premières règles édictées par le mouvement. La pratique des sports nobles en plein ainsi qu’une bonne hygiène alimentaire étaient aussi de mise. Tout ceci était révolutionnaire à l’époque.
[24] Comme de nombreux Wandervögel de sa génération, Il mourut lors de la Grande Guerre, à 30 ans au combat en 1917, en terres baltiques.
[25] A l’instar des fleuves Elivagar au pied de l’Arbre du Monde Yggdrasill, ou de la Fontaine de Mimir des Eddas, antiques récits de mythologie scandinave, thématique que l’on retrouve largement répandue dans le vieux fond mythique européen.
Bibliographie en langue française sur les Wandervögel :
- Wandervogel – Révolte contre l’esprit bourgeois, de Karl Höffkes, éditions A.C.E. (Amis de la Culture Européenne, 2001).
- À la Recherche d’une éducation nouvelle – Histoire de la jeunesse allemande, 1813-1945, par Philippe Martin, éditions du Lore (2010).
- Histoire d’une fille qui voulait vivre autrement, de Norgard Kohlhagen, éd. A.C.E. (2006)
- La Jeunesse “Bündisch” en Allemagne, d’Alain Thiémé, éd. A.C.E. (2005)